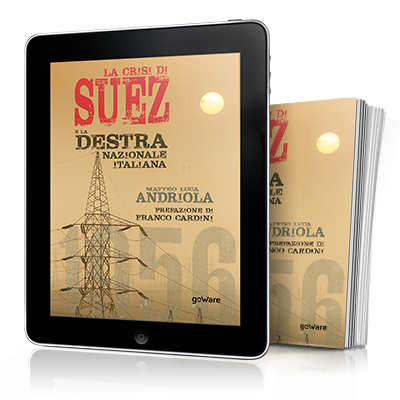Les activités du Mouvement social italien ont connu un tournant important en 1956, analysé par Matteo Luca Andriola dans l’ouvrage La crise de Suez et la droite nationale italienne, publiée en 2020 par la maison d’édition florentine goWare.
Une « admiration quasi adolescente pour Nasser », le militantisme politique et la passion authentique pour la « véritable » patrie européenne (qui déboucha par la suite sur l’adhésion au mouvement communautaire Jeune Europe) sont évoqués par Franco Cardini dans la préface, ainsi que les abus et les violences perpétrés par les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale.
Répartis sur différentes périodes, certains éléments du récit – Mussolini brandissant l’épée de l’Islam et entretenant de bonnes relations avec l’Union des sionistes révisionnistes de Jabotinsky, les raisons de la fascination exercée en partie par la civilisation musulmane sur Hitler – ne s’inscrivent pas toujours de manière linéaire dans un contexte qui met en évidence l’importance stratégique de l’Égypte pour les forces de l’Axe.
C’est un fil ténu qui se déroule tout au long du « flirt » d’une partie de l’exécutif de Nasser et des Officiers libres avec les nazis réfugiés dans le pays après 1945, jusqu’à la nomination de Johann von Leers, ancien hiérarque converti à l’islam, à la tête de la propagande anti-juive de l’État.
La nationalisation de la Société internationale du canal de Suez – qui prit par surprise la France et l’Angleterre, détentrices de la majorité des actions de la compagnie chargée de la gestion du transit des marchandises – peut être interprétée comme un affront aux puissances qui avaient changé d’avis sur leur volonté de financer le projet de construction du barrage d’Assouan et qui accusaient à leur tour leur interlocuteur (non sans fondement) de chercher une aide économique, technique et des livraisons d’armes auprès de l’URSS.
En ce qui concerne le cas italien, un débat intéressant a eu lieu au sein du MSI, de la presse et des magazines plus ou moins alignés à ses côtés, ainsi que des formations de la droite extra-parlementaire : une galaxie – souvent décrite comme monolithique, mais en réalité extrêmement hétérogène – qui, selon Andriola, privilégiait une approche de la question ancrée dans une conception d’avant-guerre des relations internationales.
Le soutien à la cause d’un pays émergent comme l’Égypte se retrouve dans les articles rédigées pour le Secolo d’Italia et pour le Meridiano d’Italia par Franz Maria D’Asaro, qui décrivait le phénomène du nassérisme en soulignant le caractère patriotique des manifestations des jeunes et des militaires – mais aussi enraciné dans les bureaux gouvernementaux, les banques et les bazars – et en s’attardant sur le fait que le parti communiste local avait été interdit.
L’attitude paternaliste des ennemis contraignit le régime – une forme complexe de socialisme qui réunissait le nationalisme panarabe, la rhétorique anti-britannique, des mesures sociales qui, selon la presse missinine, faisaient écho à celles des vingt années de fascisme, et une forte charge régénératrice de la foi islamique – à accepter l’amitié de Moscou. Ce dernier élément a alarmé le Centre d’études Ordine nuovo, farouche opposant aux États-Unis (puissance manipulée, selon lui, par des lobbies juifs occultes) et partisan de Nasser, dont les intentions étaient devenues claires après les travaux de la Conférence de Bandung, acte de naissance du bloc des pays non alignés, en tant que guide pour la revanche des pays arabes contre les « démoploutocraties».
Deux télégrammes publiés par le mensuel Ordine Nuovo et adressés aux ambassades britannique et égyptienne par la Fédération nationale des combattants de la République sociale italienne indiquent que ce groupe suivait une voie similaire – Corrispondenza Repubblicana, son organe officiel, louait le panarabisme nassérien comme une union de pays de même langue, de même race et de même religion – à l’instar du groupe L’Orologio, pro-arabe et partisan des luttes anti-impérialistes de la Chine maoïste, des Vietcongs et des Palestiniens.
Les hebdomadaires Il Nazionale – qui, par la plume d’Ezio Maria Gray, signalait le danger d’un réveil de la spiritualité islamique, porteuse de fanatisme religieux et d’esprit de conquête – et Il Borghese, étaient critiques à l’égard de la ligne diplomatique prudente des États-Unis et des partisans italiens du gouvernement du raïs, « coupables » de défendre en réalité les accords qu’il avait conclus avec l’ENI.
C’est l’ancien ambassadeur Filippo Anfuso, lié à une vision géopolitique qui, partant de l’idée d’une Europe-Nation fédérée sur un modèle social de type corporatif, opposait à la conception bipolaire du monde celle de l’Eurafrique, selon laquelle l’Italie aurait dû se tailler un rôle central en Méditerranée, qui a identifié la véritable raison du conflit dans le domaine énergétique, dénonçant l’impuissance des organismes internationaux et la passivité italienne.
Au niveau international, les tentatives de résolution de la crise se sont traduites par la création du Comité des Cinq. La non-participation italienne a attiré les critiques du MSI : craignant des concessions envers Tito (qui n’avait pas hésité, des années auparavant, à bénéficier de l’aide britannique pour l’Istrie, se montrant pro-soviétique dans la question de Suez), on s’est demandé pourquoi le gouvernement avait besoin de se rallier à des attitudes bellicistes sans être consulté.
Le Secolo d’Italia compara la politique de contre-mesures du Foreign Office à l’encontre de l’Égypte (visant à constituer une association d’utilisateurs avec le personnel de l’ancienne Compagnie) à celle des sanctions contre l’Italie fasciste après la campagne d’Abyssinie, sans cacher sa rancœur envers la France ; Edgardo Beltrametti s’est quant à lui attardé sur le refus américain de régler le différend par le biais de l’OTAN, sans se rendre compte que la stratégie de Washington visait, selon l’auteur, à éloigner les pays impliqués dans le processus de décolonisation du bloc socialiste.
L’escalade militaire – affrontements à la frontière entre Israël et la Jordanie, attaque israélienne dans la péninsule du Sinaï avec le soutien de Paris et de Londres, intéressés à imposer leur statu quo sur le canal – a conduit à une situation de blocage, favorisée par l’engagement parallèle de Moscou dans la répression sévère de la révolte hongroise et par l’apparente distraction des États-Unis pour les élections présidentielles.
Si ces derniers ont en réalité fait valoir leur poids en refusant d’accorder des livraisons d’urgence de pétrole aux pays européens pendant le blocus du transit, l’ancien diplomate Alberto Mellini Ponce de Leon a fait remarquer que le geste de Nasser de révoquer une concession en violation d’un contrat avec des particuliers (la concession aurait expiré en 1968) constituait, d’un point de vue théorique, un obstacle qui pouvait être résolu par une décision arbitrale.
Il Popolo italiano s’est rangé contre l’impérialisme britannique, publiant des photos montrant des femmes égyptiennes en uniforme militaire et armées contre l’envahisseur ; en effet, des bombardements massifs ont frappé certaines villes, faisant de nombreuses victimes civiles, après la décision du gouvernement du Caire de ne pas autoriser le débarquement des Britanniques et des Français.
La crise fut résolue à la suite des menaces de représailles de l’URSS, des demandes des États-Unis de retrait « sans conditions » et d’évacuation de la zone du canal, définies par l’intermédiaire des casques bleus de l’ONU : « La leçon inattendue qui nous a été donnée comme un jeu exemplaire des États-Unis et de l’Union soviétique…l’alliance implicite et logique qui marchait sur la voie du partage du monde en deux zones d’influence » – rappelle Cardini – mit fin aux velléités des anciens empires coloniaux de rivaliser à armes égales avec les deux superpuissances.
Andriola soutient que le parti de la Flamme a progressivement changé de paradigme face à l’expansionnisme de plus en plus agressif de Moscou au Moyen-Orient et a retiré son soutien à Nasser en réaction au choc de son prétendu virage pro-soviétique, au point de voir dans la crise de Suez un « tournant » capable de modifier en profondeur les idées de la plupart des membres du parti, qui ont renforcé au cours des années 60 une identité pro-atlantique et ont commencé à considérer Israël comme une « enclave européenne et occidentale » dans la région.
C’est une conclusion – à l’humble avis de l’auteur – peu convaincante et qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, à tel point que l’auteur lui-même est contraint de la nuancer, admettant le poids de nombreuses exceptions significatives.
Andrea Scarano (Barbadillo.it)