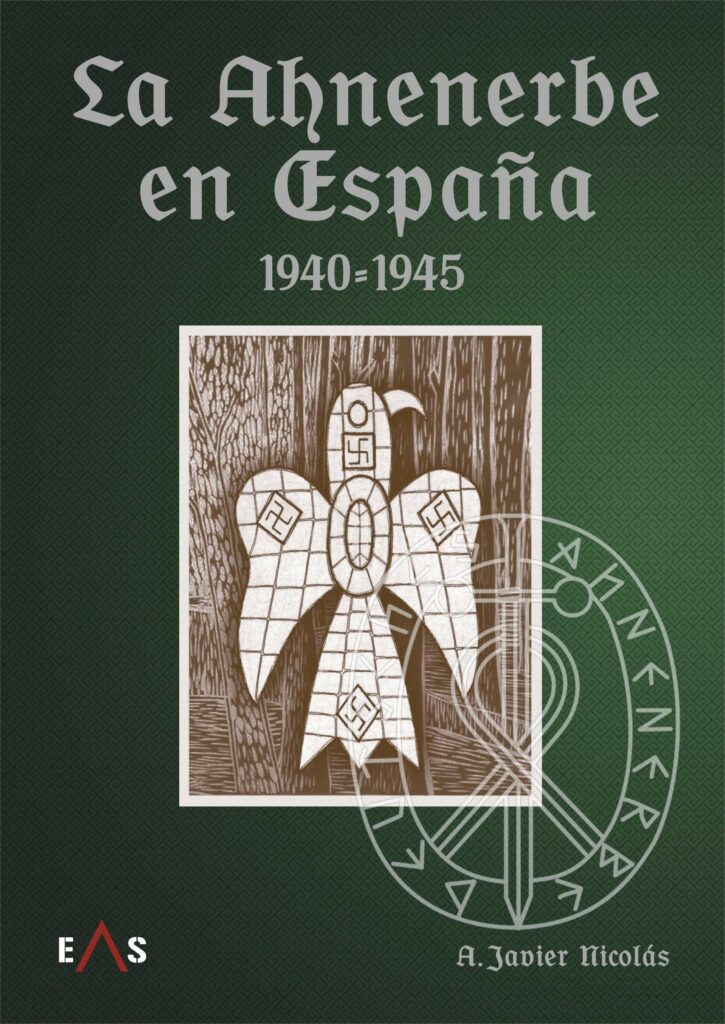Dans ce que l’on pourrait appeler une histoire-poubelle – ici sans intention péjorative – du 20ème siècle, composée à partir des décombres, ruines et débris des événements que l’on peut considérer comme « réels », Heinrich Himmler a fait plus que prêter son visage à Arnold Toht, le petit Sturmbannführer qui s’est totalement consacré à s’emparer de l’Arche d’Alliance dans un film américain bien connu. Selon cette version post-historique de l’histoire, Himmler était un ésotériste invétéré qui s’entourait de joueurs de cartes et de fous d’alchimie, d’astro-archéologie et, bien sûr, de fabrication d’homoncules à des fins hautes en couleur, allant de la recherche au Tibet de la cité perdue de Shambhala (et de la porte introuvable qui relie notre monde à la Terre creuse) au contact avec des extraterrestres, des dieux primordiaux ou des divinités babyloniennes dans des scénarios très originaux. Il a planifié, à partir d’un prétendu « bureau occulte » nazi, la conception, le développement et la construction de soucoupes volantes. Il a retrouvé la lance de Longinus et le Saint Graal. Ses expéditions autour du monde visaient à localiser les centres énergétiques de la planète et à les utiliser pour fournir au Troisième Reich la vigueur cosmique supplémentaire qui en ferait le Reich de mille ans, et à Hitler un immortel doté de pouvoirs surhumains et de la musique de Wagner. Rien de tout cela n’apparaît, bien sûr, dans ce livre sensationnel et érudit, facile à lire et formidablement documenté.
La vérité est que Himmler, comme beaucoup de hauts dirigeants nazis et bon nombre de ses partisans et coreligionnaires, était un homme très cultivé. Ses voyages à travers le monde, presque toujours à des fins géopolitiques (par exemple, sa visite à Madrid en 1940 pour planifier avec Franco et Serrano Suñer la rencontre avec Hitler à Hendaye), il les transformait en prétextes pour visiter des musées, des cathédrales et des tombes de personnalités historiques. Certes, il était avant tout un homme au service d’une vision et, en tant que tel, ses préoccupations concernaient principalement la construction d’un monde nouveau, mais il savait d’une certaine manière faire coïncider cette préoccupation avec ses propres préoccupations de fanatique constamment interpellé par un mystère existentiel, qui, dans son cas, provenait du fait qu’il avait autrefois fait partie, sous la forme de ses ancêtres, d’une civilisation supérieure et malheureusement perdue. Les traces de cette civilisation se retrouvent encore dans de nombreux endroits du monde : l’Iran, le Tibet, l’Islande, les paysages allemands, les cimetières des rois wisigoths, les étranges statues et pyramides sous-marines enfouies sous les îles Fortunées. Pour collecter et étudier toute cette histoire perdue, il inventa son propre département au sein de la SS, auquel il lui donna le nom d’Ahnenerbe, ou « héritage des ancêtres », une sorte de musée monstrueux – au sens étymologique du terme mais aussi dans sa signification terrifiante – dans les couloirs duquel on croisait des linguistes et des botanistes exaltés avec des médecins en blouse tachée de sang. Ce département était comme un point aleph de l’expérience humaine : là, l’éclat de notre âge d’or perdu, quand nous étions encore des dieux, se mêlait aux cris des suppliciés au service de la Science (cris qui, je ne sais pas si c’est surprenant, allaient trouver un écho souterrain dans l’avenir).
Conçue en 1933-1934 mais concrétisée en 1935, deux ans après l’arrivée au pouvoir du parti national-socialiste, l’Ahnenerbe avait pour mission d’enquêter sur l’héritage racial et traditionnel – entendu comme le contenant d’un esprit commun et d’une grande conscience collective – de l’Allemagne moderne. Himmler plaça à la tête de l’Ahnenerbe des individus à la fois extrêmement cultivés et extrêmement complexes – Walter Wüst, peut-être moins complexe, a poursuivi la voie ouverte au 19e siècle par Wilhelm Schlegel et a excellé en tant qu’indologue, avec la tâche supplémentaire de fournir une justification scientifique à la « vision aryenne du monde ».
La mission d’hommes comme Wüst – mort de vieillesse mais ostracisé – ou Wolfram Sievers, collectionneur de squelettes et futur condamné du Procès des médecins, était quelque chose d’apparemment aussi anodin que de prouver l’existence d’une civilisation germanique, proche de la civilisation gréco-romaine qu’Hitler admirait bien plus qu’il ne s’intéressait à la mythologie aryenne de Heinrich Himmler. Mais on comprend mieux leur travail si l’on s’éloigne des définitions a priori : la science qui devait sous-tendre les activités de l’Ahnenerbe (et qui englobait des disciplines aussi variées que la musique, la linguistique, la jurisprudence, la peinture, le folklore et les sciences naturelles, avec un intérêt particulier pour des recherches presque à la limite de l’orthodoxie comme celles développées sur les sourciers et les radiesthésistes pour apprendre à localiser les sources et les aquifères) s’éloigna des affaires germaniques pour se mettre au service de la guerre. De nombreuses expériences médicales menées dans les camps de concentration les plus célèbres pour le traitement particulièrement bestial des prisonniers ont eu pour protagonistes des membres de l’Ahnenerbe, durs mais éblouissants. Ce n’est pas seulement pour cette raison que l’Ahnenerbe était considérée comme une société criminelle : en tant qu’office dépendant de la SS, elle était condamnée dès la perte de la chute de l’Allemagne.
L’Ahnenerbe a failli avoir une succursale en Espagne, comme le raconte l’universitaire Alberto Javier Nicolás dans ce livre – un ouvrage animé par une pure passion et accompagné d’une impressionnante documentation graphique – si l’architecte José Luis Arrese, alors gouverneur civil de Malaga, plus tard ministre-secrétaire général du FET et des JONS, et encore plus tard ministre du logement, avait eu de meilleurs moyens d’arriver à ses fins et si Franco avait donné son accord au projet, ce qui est douteux. Arrese ne reçut pas l’argent qui aurait permis de fonder l’Ahnenerbe espagnole et dut se contenter de la collaboration du bureau allemand pour le nettoyage, la récupération et le catalogage des reliques exhumées à Castiltierra (Ségovie) du plus grand cimetière wisigoth d’Europe qui furent ensuite perdues sur leur chemin du retour vers l’Espagne (encadrons cette perte par de prudents guillemets).
Himmler ne put s’empêcher de s’intéresser aux reliques wisigothiques et demanda à visiter Castiltierra lors de son voyage en Espagne. Auparavant, il avait visité les peintures du musée San Telmo, la cathédrale de Burgos et le tombeau du Cid, ainsi que l’Alcazar de Tolède en compagnie du général Moscardó. Plus tard, il s’envolera pour Barcelone afin de visiter Montserrat, le Monsalvat du Parsifal de Wagner, avec ses dangereux contreforts au sud, où se trouvait le château enchanté de Klingsor. Et là, dans la bibliothèque du monastère, où il fut chaleureusement accueilli par les moines, Himmler s’enquit du Graal, sur lequel personne ne pouvait le renseigner (peu de temps après, il enverra l’un de ses hommes accomplir la prodigieuse tâche de le rechercher), et avant de partir, il se fit photographier avec la Moreneta. Entre-temps, il était déjà passé par Ségovie, avait mangé à Cándido, avait « fouillé des Wisigoths », comme l’écrivit l’archéologue Pérez de Barradas dans son style sinistrement économique – « Dans l’après-midi, Julio m’a suggéré d’aller à Castiltierra pour fouiller des Wisigoths en vue de la visite de Himmler » – et avait écouté avec un vif intérêt l’histoire des grandes momies guanches aux cheveux clairs déterrées aux Canaries. Atlantes, anciens habitants d’un autre peuple mythique : Thulé ? Quoi qu’il en soit, l’Ahnenerbe ne pouvait manquer de faire des fouilles également aux îles Canaries, où l’on tenta de localiser une idole féminine en forme de colonne, la Weltsäule, « l’axe, le pilier ou la colonne du monde attribuée à la cosmogonie guanche », qui, pour les archéologues allemands, était liée à l’Irminsul nordique, la colonne qui reliait le ciel à la terre vénérée par les Saxons et qui, dit-on, aurait fini par être abattue par Charlemagne. (Soit dit en passant, le Julio auquel Barradas fait allusion dans son journal était un individu assez particulier, Julio Martínez Santa Olalla, un archéologue formé en Allemagne et l’indispensable protagoniste de ce livre ; un type « grand, blond, très myope, généralement bon avec ses étudiants et dur avec ses collègues, qui ne l’aimaient pas. Il parlait d’une manière ironique, dédaigneuse et languissante », selon la description de Julio Caro Baroja, et qui, avec toute sa nonchalance et son arrogance – et la « cour de disciples féminines qui l’admiraient » – en vint à surprendre Himmler avec son allemand presque parfait. Entre 22 et 25 ans, il avait été professeur à Bonn, avait admiré Mussolini et, à son retour en Espagne, avait été sur le point d’être fusillé par les rouges, ce qui serait inévitablement arrivé si Julián Besteiro n’était pas intervenu en sa faveur).
S’il est vrai que lesrecherches archéologiques, les énigmes historiques, l’attirail romain et les uniformes Hugo Boss des nazis ont toujours suscité une fascination générale, cette fascination est encore plus grande lorsque la mystique s’éloigne des clichés et apparaît soudain dans des lieux aussi peu susceptibles, en principe, d’accueillir ne serait-ce qu’une petite histoire du nazisme que le restaurant Cándido ou les champs ségoviens où furent enterrés, il y a des siècles, quelques princes wisigoths. Alors, est-il vrai qu’ici, sous un monument érigé avant la naissance du Christ par une poignée de soldats romains pour canaliser l’eau des montagnes lointaines, sur ces mêmes pavés inégaux, on a entendu les bottes de Heinrich Himmler ? Le petit Sturmbannführer – pas si petit que ça – dans le restaurant du coin a-t-il occupé l’ une des chaises où sont aujourd’hui assis des touristes français ou américains ? Je sais que ces questions n’ajoutent rien à l’histoire suffisamment fabuleuse racontée par Alberto Javier Nicolás, mais elles ajoutent des coins et des recoins à une histoire que l’on croyait suffisamment connue. Il me reste cependant les mots beaucoup plus sereins et terre-à-terre de son auteur, qui traitent, comme l’aboutissement d’un travail franchement colossal, de ce qui est vraiment pertinent :
Cette étude a cherché à raconter les recherches qui se sont déroulées en à peine cinq ans, en les articulant autour de la figure de l’archéologue de Burgos, Santa Olalla. Leur arrêt, dû à l’issue finale de la guerre mondiale, n’a pas permis de finaliser ce travail énorme. Il reste encore un certain nombre de reliquats historiographiques… des questions et des réponses que les futurs chercheurs pourront et devront continuer à se poser. Le pont-levis a été relevé.
Ou, pour le dire autrement, cette histoire a bien eu lieu, et aussi loin que nous soyons allés – ce qui n’est pas rien – elle valait la peine d’être racontée.
Lorenzo Luengo
Titre: La Ahnenerbe en España. 1940-1945. Autor: Alberto Javier Nicolás. Páginas: 290. Editorial: EAS (2021).