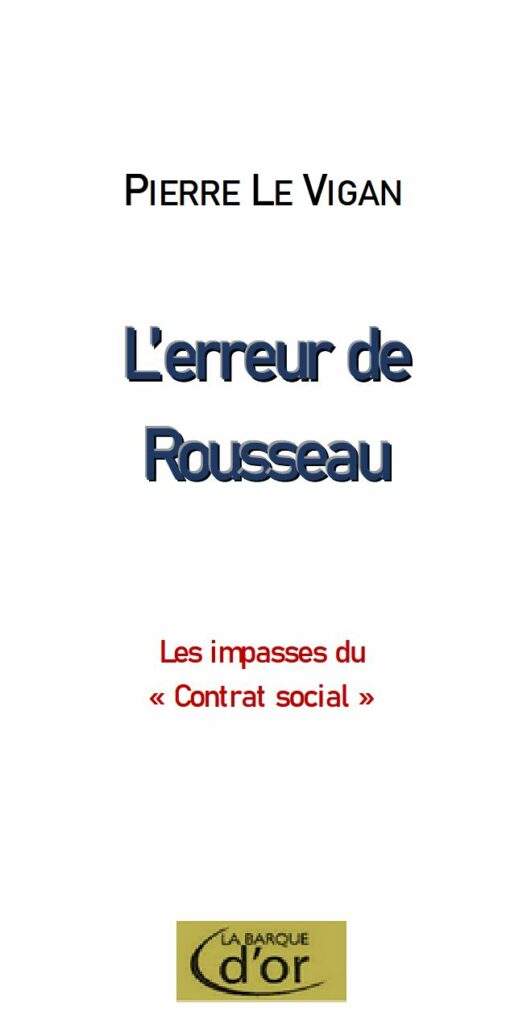Collaborateur de diverses revues radicales depuis les années 1970, Pierre Le Vigan a toujours été intéressé par des problématiques peu habituelles. Il a souvent apporté un regard neuf sur celles-ci. Il a publié depuis les années 2000 quelque trente livres dont les sujets sont très variés, puisqu’ils vont de la ville et l’urbanisme au mal-être psychique dans le monde moderne, dans la lignée des travaux d’un Alain Ehrenberg, à la critique de la société marchande et du capitalisme mondialiste et prédateur.
A cela s’ajoute une somme considérable, à la fois littéraire, esthétique et philosophique, les quatre tomes de ses « carnets de fureur et de jubilation » : Le front du cachalot, La tyrannie de la transparence, Chronique des temps modernes, Soudain la postmodernité (chez Dualpha et aux éditions « La Barque d’or », disponibles sur les grandes plateformes de diffusion). Pierre Le Vigan est aussi un passionné de l’étude des idées, de leur généalogie, et des thèmes philosophiques (Avez-vous compris les philosophes ? I-V, La Barque d’or) qui engagent le sens même de notre vie et de nos actes.
Son dernier essai porte sur Jean-Jacques Rousseau, L’erreur de Rousseau, sous-titré Les impasses du Contrat social. Bref et remarquablement synthétique, il est appelé à être une référence tant il est à la fois rigoureux, parfaitement informé et nuancé.
***
On a vu en Rousseau le père de la Terreur de 1793-94, du fait de la radicalité de son appel aux vertus des citoyens. De fait, Robespierre ne cachait pas son admiration pour Jean-Jacques. Mais de même que si Staline se référait à Marx, cela ne veut pas dire que Marx aurait été stalinien. Rousseau n’aurait pas été forcément robespierriste. Toutefois, cela montre une logique possible (non la seule) du rousseauisme. [Et du reste, réduire Robespierre à la Terreur est une imbécilité] Par extension avec ce lien Rousseau-Révolution de 1993-94, on a pu mettre les idées de Jean-Jacques en lien avec la Révolution bolchévique d’octobre 1917. C’est lui faire un lourd héritage.
Dans un registre plus anthropologique, on a redécouvert un Rousseau hostile au culte du progrès (celui de Turgot, de Condorcet). Un Rousseau hostile à la modernité technique et artistique. Et même critique face aux ravages de « l’éducation ». Un Rousseau refusant la société de convoitises, des désirs et des « besoins » toujours croissants. [Rousseau ou Sartre, dit Michel Clouscard. Ce qui veut dire qu’il faut choisir Rousseau contre Sartre). Nous redécouvrons un Rousseau rustique et rural. Un Rousseau effrayé devant « les progrès du Progrès ». Et il n’avait pourtant vu que le début.
On a vu encore en Rousseau le doctrinaire d’une démocratie réelle, non déléguée, non représentative. Une démocratie directe. On s’est avisé à juste titre que les institutions représentatives pouvaient n’être aucunement démocratiques. C’était le cas en 1791, sans suffrage universel, et c’est de plus en plus le cas dans la Vème République dénaturée que nous connaissons. [Disons-le dans une parenthèse : une république coprophile. « Il sertit d’or l’excrément ; il monte sur des métaux précieux, précieusement ouvrés, la perle noire de la bave. Quand il en arrive à ce point d’orfèvrerie et de ciselure, l’excrément lui-même devient un joyau » (Octave Mirbeau sur Léon Bloy). Une république à l’opposé de la vertu à laquelle aspire Rousseau.]
***
Rousseau semble être le doctrinaire d’une démocratie réelle, c’est-à-dire d’une démocratie directe. Il n’y a que les lois approuvées directement par le peuple qui sont valables. Mais – et c’est ce que montre Le Vigan – Rousseau reste à mi-chemin, et il conditionne la démocratie à des exigences de vertu telles que lui-même reconnait que ces institutions ne sont possibles que pour un « peuple de dieux ». « S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » (Du Contrat social, 1762). En effet, avec un « peuple de dieux », il n’y aurait pas besoin de gouvernement, celui-ci étant un intermédiaire entre la loi et son application. Un peuple de dieux se gouvernerait lui-même. Entre la loi et l’application de la loi, il n’y aurait rien.
Mais alors, puisque nous ne sommes pas un « peuple de dieux », si le gouvernement est totalement indépendant du pouvoir législatif, quand bien même celui-ci appartiendrait–il formellement au peuple, que reste-t-il vraiment de la souveraineté populaire ? Il est bien beau de dire que les lois ne sont valables que si le peuple les a approuvées, mais si leur exécution est laissé entièrement et sans contrôle à un gouvernement, quelles garanties de leur non détournement possède le peuple ? Et surtout, – Le Vigan insiste sur cet élément essentiel – cette souveraineté populaire consiste à approuver ou non les lois, mais ne consiste pas à les élaborer, à les discuter, à les amender, ce qui est le rôle des magistrats.
Mais que sont ces derniers ? Une caste dont l’origine et la légitimité reste floue ; en fait, une élite auto-instituée et supposée vertueuse. Mais qui valide cette vertu ? Et qui valide la vertu des valideurs de vertu ? De son côté, le gouvernement forme « comme un nouveau corps dans l’Etat ». C’est une « collection de volontés ». Et cette « collection » ne va pas forcément dans le sens de la « volonté générale ». Que faire alors, si la volonté générale est trahie ?
Le seul remède aux abus possibles du gouvernement est, nous dit Rousseau, que le peuple s’assemble. « À l’instant que le Peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue… » (Du Contrat social, III, 14). Mais quand et comment ? A l’initiative de qui le peuple se rassemblera-t-il ? Spontanément ? Et comment peut-il s’assembler dans une grande nation ? Rousseau dit lui-même que c’est quasiment impossible. La souveraineté du peuple n’est donc possible que pour les nations de très petite taille ; Rousseau évoque 20 000 habitants.
Comment le Souverain peut-il alors domestiquer le Gouvernement ? Par la séparation totale entre ces deux instances, le peuple ne peut révoquer le gouvernement. Le peuple ne peut que voter ou non des lois qu’il n’a pas le droit de proposer, ni de discuter ni d’amender. Exemple : si les magistrats ne demandent pas au peuple s’il veut plus ou moins d’immigration, il ne pourra jamais se prononcer sur cette question. Le peuple ne peut répondre qu’aux questions qu’on lui pose.
C’est là l’erreur de Rousseau.
Rousseau veut transformer les hommes. Il veut les rendre vertueux. Notamment en imposant une religion civile. Un culte du civisme. Un patriotisme intégral, tourné vers la défense à la fois intérieure et extérieure de la patrie et de la souveraineté du peuple. Qui ferait que la volonté générale serait la volonté de tous et de chacun. Très bien.
Mais s’il est légitime de vouloir améliorer les hommes, encore faut-il les prendre tels qu’ils sont à l’origine. C’est ce que ne veut pas voir Rousseau. C’est son autre grande erreur. Il en est d’ailleurs tout à fait conscient. Et il tombe alors dans le désespoir et l’apologie, hobbesienne, de la dictature d’un « grand Prince ». On ne peut bien entendu pas reprocher à Rousseau d’avoir voulu tirer l’homme vers le haut, du côté des exigences d’une religion civile. Mais on ne peut que constater qu’il s’est enfermé dans une logique du « tout ou rien » qui aboutit au final à légitimer les plus extrêmes despotismes. Ce que Rousseau appelle donc le « Hobbisme » – de Thomas Hobbes.
***
Il y a donc chez Rousseau bien des contradictions et mêmes des impasses. Mais cela ne suffit pas à invalider toutes ses idées. Cela rend nécessaire un examen critique de ses thèses, présentes dans le Contrat social bien entendu, mais aussi dans Emile ou de l’éducation, dans Rousseau juge de Jean Jacques, dans les deux Discours (sur les sciences et les arts, sur l’origine de l’inégalité), etc.
Constructiviste extrême au nom de la vertu, Rousseau veut néanmoins que la loi ne dérange que le moins possible les coutumes (on dirait : les traditions). Individualiste, il veut que l’individu abandonne tout au corps collectif dont il est co-souverain. On serait tenté de dire qu’il a inventé le « en même temps ». Mais, malgré les insuffisances de sa théorie du point de vue démocratique – et c’est le point de vue qu’adopte Le Vigan : en quoi Rousseau n’est pas pleinement démocrate, en quoi il est insuffisamment démocrate – Rousseau, par son ambition de réconcilier l’individu et le corps collectif de la nation reste un auteur à lire et à travailler.
C’est aussi un anticosmopolite, et un patriote inconditionnel. Pour Jean-Jacques, les droits du citoyen et des devoirs doivent toujours passer avant les droits de l’homme. A notre époque, cela en ferait un auteur ostracisé. Comment disent les journalistes ? « Aux thèses controversées. » Une raison supplémentaire de lire ou relire Rousseau. Et de lire le Rousseau de Le Vigan.
Jean-Marie Soustrade
Pierre Le Vigan, L’erreur de Rousseau. Les impasses du Contrat social, La Barque d’or, 92 pages.