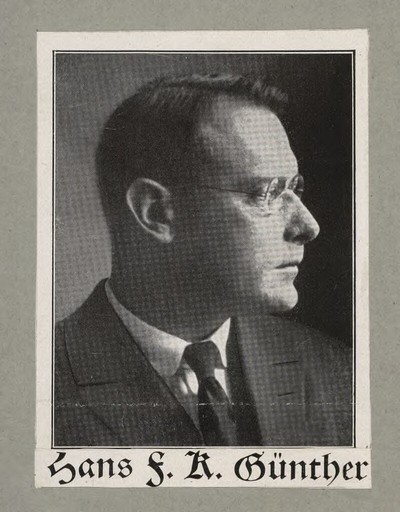Appartenant à l’aile néo-païenne des völkischen, l’anthropologue Hans Günther est à l’origine d’une abondante œuvre scientifique qui fut saluée en son temps par Julius Evola.
Né le 16 février 1891 à Fribourg en Brisgau, Hans F.K. Günther poursuit dans cette ville de la Forêt-Noire des études de linguistique comparée et de philologie germanique. Il assistera également au cours de Durkheim à la Sorbonne durant le semestre d’été 1911, avant d’obtenir son doctorat en 1914.
Il publie en 1920 son premier ouvrage, un court essai consacré à la pensée héroïque intitulé Ritter, tod und teufel : der heldische gedanke (Le Chevalier, la mort et le diable : L’idée héroïque), allusion à la célèbre gravure de Dürer. Son éditeur munichois, Julius Friedrich Lehmann, enthousiasmé, lui propose d’écrire un manuel de raciologie destinée
au grand public. En juillet 1922, sort des presses Rassenkunde des deutschen volkes (Raciologie du peuple allemand), qui traite de la répartition des types raciaux en Allemagne, suivi, dès 1924, de Rassenkunde Europas (Raciologie de l’Europe). De nombreuses éditions se succéderont jusqu’en 1942 et il s’en vendra 124 000 exemplaires. En 1929, paraît une édition populaire abrégée, Kleine Rassenkunde des deutschen volkes, rapidement surnommée Volksgünther, qui sera, elle, tirée à 295 000 exemplaires.
L’idée nordique
Appliquant à l’Allemagne la méthode déjà employée par les anthropologues anglo-saxons Beddoe (Races of Britain, 1885) et Ripley (The Races of Europe, 1899), Günther reprend la classification des races européennes établie par le naturaliste et anthropologue franco-russe Joseph Deniker, qui a introduit la notion de race nordique dans le débat scientifique en 1900. Pratiquant l’anthropologie biologique, Günther décrit précisément les phénotypes raciaux comme la corpulence, la forme des crânes, la couleur des cheveux et des yeux, etc. Il s’attache également à caractériser les traits psychiques des races européennes et subira, dès 1923, l’influence de Ludwig Ferdinand Clauss, concepteur d’une « psychologie des
races ».
Dans Der Nordische Gedanke in Deutschland, 1920-1940 (1), ouvrage de référence sur « l’idée nordique », Hans-Jürgen Lutzhöft précise que, si la race favorite de Gunther était bien la race nordique, jamais il ne dénigrera les autres races européennes présentes en Allemagne, qu’il s’agisse de la race méditerranéenne ou de la race alpine (dite aussi ostique). Au fil des rééditions de son ouvrage, il intégrera trois nouvelles races typologiques : la race dinarique, protégée par la géographie des Balkans ; la race est-baltique, issue de mélange entre Nordiques et Ostiques, caractérisée par de forts éléments raciaux asiatiques et mongols ; et la race dalique ou falique, cousine de la race nordique, caractérisée par une silhouette épaisse, des cheveux blonds et des yeux bleus, dont les membres sont considérés comme des fossiles vivants descendant directement de l’homme de Cro-Magnon.
« L’idée nordique » est formulée en Allemagne en 1923 par le livre éponyme que publie Fritz Lenz. Deux ans plus tard, Günther popularise ce concept dans Der Nordische Gedanke unter den Deutschen (L’Idée nordique chez les Allemands). Conscient que seuls 6 % des Allemands sont de purs nordiques et que 50 % de la population allemande porte en elle
des composantes nordiques, il prône une renordicisation (aufnordung) du peuple allemand. Cette politique doit être fondée sur l’augmentation programmée des mariages entre nordiques, mariages transcendant les frontières nationales, Günther montrant l’exemple en épousant une Norvégienne. En contradiction avec l’État-nation allemand existant, il se prononce pour l’avènement d’un Empire regroupant toutes les régions septentrionales et centrales de l’Europe à dominante raciale nordique. D’ailleurs, dès 1923 il s’installe en Suède, travaillant notamment, à l’Institut d’État de biologie raciale, où il est l’assistant du professeur Herman Lundborg, qui lui permet d’obtenir une charge de cours à l’Université d’Uppsala. En 1929, suite à la crise économique, il se retrouve à court d’argent, ce qui l’oblige à rentrer dans son pays où il obtient un poste de professeur auxiliaire de Gymnasium à Dresde.
Günther la race
Très tôt, les nationaux-socialistes s’intéressent aux travaux de Günther. Dans le Völkischer Beobachter du 7 mai 1925, Rosenberg réclame la présence d’un homme de sa stature à la Deutsche Akademie. En 1930, Wilhelm Frick, ministre national-socialiste de l’Intérieur et de l’Éducation populaire du Land de Thuringe, le fait nommer à un poste de professeur à l’Université d’Iéna. Le corps académique s’y oppose, arguant qu’il n’a qu’une qualification en philologie, et Frick doit créer pour lui une chaire « d’anthropologie sociale ». Le 15 novembre 1930, Günther prononce sa leçon inaugurale en l’absence du recteur et du doyen de sa faculté, mais devant de nombreuses personnalités nationales-socialistes, notamment Hitler, Darré et Goering.
Bien que son éditeur Lehmann soit membre du NSDAP depuis 1920, Günther n’y adhère formellement qu’en 1932, un an avant l’accession au pouvoir d’Hitler. Au sein du parti, il est surnommé Rassengünther, « Günther la race ». À partir de 1933, sa carrière universitaire connaît un essor fulgurant : il enseigne aux universités de Berlin (1935-1939), puis de Fribourg en Brisgau (1939-1944), la raciologie, l’anthropo-sociologie et l’hygiène raciale (rassenhygiene). Rosenberg lui fait accorder le prix de science du NSDAP en 1935. En 1936, il reçoit une autre distinction honorifique, la plaquette Rodolf Virchow de la Société berlinoise d’Ethnologie, d’Anthropologie et de Proto-histoire, dirigée par Eugen Fischer. En 1937, il entre au comité directeur de la Société Allemande de Philosophie.
Sur le plan éditorial, il publie, en 1932, un ouvrage sur l’influence indo-européenne en Asie (Die Nordische Gedanke bei den Indogermanen Asiens, Lehmann, 1934), suivi, en 1934, d’une étude de la conception du monde indo-européenne, Frömmigkeit nordischer artung (Piété de la race nordique), à travers une relecture des textes de l’antiquité sanskrite, de la Grèce et de la Rome classiques, de l’Edda scandinave et de la littérature romantique allemande. Son dernier livre sur les problèmes raciaux, Herkunft und rassengeschichte
der Germanen, paraît en 1935. Il se préoccupera ensuite principalement d’hérédité, de sociologie de la famille, d’histoire des religions.
Hans Günther termine sa Rassenkunde des deutschen volkes par cette réflexion : « L’Allemand de conviction nordique se devra de rechercher pour son peuple une nouvelle cohésion religieuse issue de l’esprit nordique » (2). Élevé dans la religion protestante, il a quitté l’Église réformée en 1925, et dès 1933, année de sa constitution, il se rallie au Deutsche Glaubensbewegung, ou Mouvement de la Foi Allemande, un groupe néo-païen prônant un « culte de l’âme et de la race nordiques », fondé par l’indologue Wilhelm Hauer et le comte Ernst Zu Reventlow, député membre de l’aile gauche du NSDAP. Il en sera un partisan indéfectible et, jusqu’à sa mort, il continuera de se déclarer païen.
Pour son 50e anniversaire, le 16 février 1941, il reçoit la Médaille Gœthe d’Art et de Science et l’insigne d’or du parti. Toutefois, en 1944, les autorités du IIIe Reich censurent un manuscrit, intitulé Die Unehelichen in erbkundlicher betrachtung (Les Enfants illégitimes vus sous l’angle des notions d’hérédité), dans lequel il défend énergiquement la monogamie et la famille traditionnelle qui, seules, permettront de redresser le patrimoine génétique germanique mis en danger par l’urbanisation croissante. Il s’agit d’une réponse à Martin Bormann qui envisageait d’instaurer une institution polygamique avec une femme principale et des femmes secondaires ou « amantes légales », toutes destinées à concevoir des enfants. En bon eugéniste, Günther prend aussi ses distances par rapport à la politique familiale nataliste du Reich : pour lui, une politique raciale ne doit pas viser à l’accroissement quantitatif de la population mais à son amélioration qualitative. Confié à l’impression à l’automne de 1943, le livre fut interdit quelques mois plus tard, à l’instigation de Goebbels, de Himmler et de Bormann.
L’après-guerre
Après trois ans passés dans un camp d’internement, Günther passe devant la chambre de « dénazification » le 18 août 1949. Celle-ci ne retient aucune charge contre lui, et souligne qu’« il a toujours été actif dans les milieux scientifiques internationaux et n’est jamais tombé dans la haine antisémite ». Il reprend immédiatement ses travaux, et, dès 1951, il se remet à publier. En 1952, paraît chez Payot une traduction française de son ouvrage sur le mariage, Le Mariage, ses formes, son origine, dans lequel il réfute les thèses du « matriarcat préhistorique » et de la « promiscuité primitive ». En 1953, il devient membre correspondant de l’American Society of Human Genetics. En 1956 et 1957 paraissent ses
deux grands livres d’histoire des peuples grec et romain : Lebensgeschichte des hellenischen volkes (Histoire biologique du peuple grec) et Lebensgeschichte des römischen volkes (Histoire biologique du peuple romain), tous deux repris de travaux antérieurs, commencés en 1929. En 1959, il publie sous le pseudonyme de Ludwig Winter Der Begabungsschwund in Europa (Le Déclin du talent en Europe). En 1963, paraît la 6e édition, revue et corrigée, de Frömmigkeit nordischer artung, qui servira de base, avec l’édition anglaise plus complète de 1967 (Religious attitudes of the Indo-Europeans), à la version française, Religiosité indo-européenne – dont le titre est dérivé de celui d’une édition italienne, Religiosita indoeuropea. Suivent encore Bauernglaube (1965), un petit essai sur la pensée de Platon, Platon als hüter des lebens (1966), Vererbung und umwelt (1967), etc.
Après la mort de sa femme en 1966, Günther vit encore plus retiré qu’auparavant. En 1969, il publie ses mémoires, Mein Eindruck von Adolf Hitler (Mon témoignage sur Adolf Hitler), extrêmement critiques sur le IIIe Reich. « L’idéal social de Günther, écrit Robert Steuckers dans la préface de Religiosité indo-européenne, c’est celui d’un paysannat libre, sans État, a-politique, centré sur le clan cimenté par les liens de consanguinité. En Scandinavie, dans certains villages de Westphalie et du Schleswig-Holstein, dans le nord-ouest des États-Unis où se sont fixés de nombreux paysans norvégiens et suédois, un tel paysannat existait et subsiste encore très timidement. Cet idéal n’a jamais pu être concrétisé sous le IIIe Reich. » (3)
Épuisé par la maladie, il meurt à Fribourg en Brisgau, le 25 septembre 1968, à l’âge de 77 ans.
Édouard Rix.
Notes
1 Hans-Jürgen Lutzhöft, Der Nordische Gedanke in Deutschland, 1920-1940, Ernst Klett Verlag, 1971.
2 Hans Günther, Rassenkunde des deutschen volkes, Lehmann Verlag, 12e éd., p. 425.
3 Hans Günther, Religiosité indo-européenne, Éditions du Lore, 2013, p. 16.