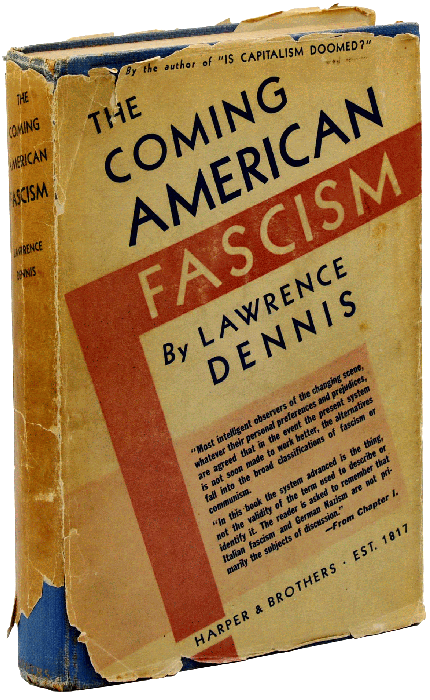Dennis naît en 1893 à Atlanta, en Géorgie, de parents moyennement aisés (il s’agit d’un couple de pasteurs protestants mulatres). Il fréquente la Phillips Exeter Academy de 1913 à 1915 puis intègre l’Université de Harvard. Ses études interrompues par l’entrée américaine dans la Première Guerre mondiale, il se porte volontaire et reçoit sa promotion d’officier grâce à son assiduité en participant aux novateurs camps d’entraînement d’officiers de Plattsburgh, dans l’État de New York, en 1915 et 1917. Il sert ensuite en France comme lieutenant d’infanterie au sein d’un régiment d’état-major [à Brest, puis dans les American Expeditionary Forces de 1918 à 1919]. Pendant plusieurs mois après la démobilisation, il erre à travers l’Europe en jouant sur le marché des changes avec peu de moyens, puis retourne en Amérique pour terminer ses études à Harvard, obtenant son diplôme en 1920.
Dennis intègre le service diplomatique américain et travaille en tant que chargé d’affaires [représentant diplomatique] en Roumanie puis au Honduras. Après cela, il se rend au Nicaragua toujours comme chargé en 1926 et y reste au moment de la guérilla de Sandino et de l’intervention militaire américaine. C’est Dennis qui, sous les ordres du Département d’État, envoie le télégramme “demandant” l’intervention des marines américains au Nicaragua. Il n’a jamais été favorable à l’intervention et, après l’avoir publiquement critiquée en juin 1927 [en raison d’un massacre de population civile par les marines], il démissionne du service diplomatique. Il part alors travailler au Pérou en tant que représentant de la société bancaire internationale J. & W. Seligman & Co., la conseillant sur les prêts péruviens et sud-américains. À ce titre, il en vient à se méfier de plus en plus, et finalement à refuser invariablement, des prêts à des fins privées ou publiques consentis sans garantie sérieuse de remboursement ou des prêts à des pays dont les balances commerciales perpétuellement défavorables rendaient le remboursement pour le moins hasardeux. Il a déconseillé des prêts importants qui ont en fait été consentis et sur lesquels les débiteurs n’ont pas manqué de faire défaut. En 1932, deux ans après avoir démissionné de Seligman pour se retirer dans sa ferme de Becket, dans le Massachusetts, afin de poursuivre une carrière d’écrivain, de conférencier et d’analyste en investissement, il répond comme témoin expert devant le commission Johnson du Sénat américain enquêtant sur les pratiques de prêt internationaux ainsi que sur la défaillance de remboursement par les emprunteurs étrangers. À cette époque, il est en passe de s’imposer dans les cercles intellectuels américains comme un critique acerbe des pratiques des banques d’investissement et de l’ensemble d’un système capitaliste qui qui, de toute évidence, avait provoqué — et par là même ne pouvait pas résoudre — la dépression américaine puis mondiale. Des articles dans des revues de premier plan l’encouragent à poursuivre l’exposé systématique et approfondi de son approche qu’il adoptera pour le reste de sa vie.
La carrière de Dennis en tant que penseur dans les années 1930 et 1940 peut schématiquement être divisée en trois périodes, chacune représentée par un livre. Dans Le capitalisme est-il condamné ? (1932), il fournit sa critique fondamentale de l’entreprise commerciale capitaliste traditionnelle et souligne la nécessité d’une planification gouvernementale. L’un des principaux abus du “leadership” capitaliste privé était l’extension excessive et grotesque du crédit, au niveau interne dans l’agriculture et l’industrie et au niveau externe dans les prêts et le commerce à l’étranger (les prêts n’étant accordés que pour permettre le remboursement des prêts antérieurs, le même processus survenant alors avec ces emprunts ultérieurs ; le commerce n’est en fin compte financé que par les emprunts d’autres commerçants). Non loin derrière dans l’iniquité se trouvait le refus des capitalistes de réinjecter les capitaux, préférant thésauriser, alors que des millions de personnes étaient au chômage faute de dépenses d’investissement. Pas encore prêt à dire ce qui, le cas échéant, pourrait ou devrait remplacer cet ordre commercial dépassé et l’État libéral-démocratique qui le permettait (les deux allant nécessairement de pair, selon lui), Dennis se contente de fournir des “suggestions de modération ou de retenue” — plus précisément, une forte imposition sur les riches (de préférence pour financer des projets de travaux publics créateurs d’emplois), des tarifs douaniers élevés et des dépenses gouvernementales conséquentes pour maintenir l’emploi dans une économie nationale autosuffisante ou autarcique — ce qui pourrait allonger et adoucir les “dernières années” du capitalisme américain.
Dans Le fascisme américain à venir (1936), Dennis est enfin prêt à être encore plus précis tant dans le diagnostic que dans le remède prescriptif. Alors que la Dépression reste traumatique six ans après son commencement et trois ans après l’inauguration de la révolution “sans plan” de Roosevelt [14], Dennis prévoit l’effondrement final du système et ne propose que les alternatives du fascisme ou du communisme pour le remplacer. Il opte franchement pour la première, non seulement parce qu’elle semble avoir fait ses preuves dans certains pays d’Europe, mais parce que la seconde alternative signifierait une “élimination” désastreuse de techniciens d’entreprise de valeur — par opposition à leur recrutement par cooptation et enrôlement au service de la nation par un État fasciste. Dennis décrit longuement ce que serait “le fascisme désirable d’un homme” — mais il prend soin de souligner que tout mouvement fasciste d’ampleur en Amérique ne s’appellerait sans doute pas ainsi et surgirait très probablement sous couvert d’anti-fascisme, peut-être même dans l’appel à la croisade contre le fascisme.
Dans The Dynamics of War and Revolution de 1940 [15], Dennis explore particulièrement ce dernier thème dans le cadre d’un traitement général reliant ses idées à la scène internationale très agitée de l’époque. Il prédit une probable implication américaine dans la guerre européenne pour deux raisons. Elle est le seul moyen pour le capitalisme américain en l’état actuel de sortir enfin de sa Dépression et elle représente au plus haut point l’effort désespéré des pays ploutocrates “nantis” stagnants (Amérique et Grande-Bretagne) pour contrecarrer la montée en puissance économique et politique des dynamiques pays socialistes “démunis” (Allemagne, Italie et Russie). Son identification sans retenue des régimes d’Hitler et de Mussolini avec le camp “socialiste” avait d’ailleurs tendance à exaspérer les critiques communistes ou de gauche du livre.
Mais la guerre des États libéraux pour mettre fin au fascisme, avec sa nécessaire mobilisation des ressources des entreprises sous la direction du gouvernement assurant seul le financement, le tout accompagné de doses massives de propagande gouvernementale aux troupeaux démocratiques, n’aboutirait qu’à un renforcement des tendances “fascistes” dans les structures politiques et commerciales de ces États, et même — surtout — en cas de victoire, il pourrait de nouveau y avoir retour à un laissez-faire dont l’ère était révolue. Dennis estime que la mobilisation étatique de l’économie, qu’il considère comme inévitable et à laquelle il est favorable par principe, pourrait être orientée sur le plan intérieur vers des réformes, des travaux publics et ultimement l’auto-suffisance économique nationale. Si elle devait être dirigée vers l’extérieur dans le cadre d’une autre grande croisade étrangère censée mettre fin au « péché » dans le monde, elle continuerait probablement à suivre cette voie si lucrative pour maintenir la production, conserver un taux d’emploi élevé et conjurer la déflation, et davantage de « péchés » seraient assurément trouvés pour les besoins de la cause, justifiant les dépenses pour éradiquer le “péché originel”. Ainsi, même avant l’intervention américaine dans la guerre (au moment précis de la drôle de guerre, en fait), et sans véritable indice quant à son issue ni même quant à la liste finale des adversaires, Dennis faisait allusion à une guerre froide d’après-guerre pour l’Amérique.
Il complète ses activités d’écrivain politique des années 1930 et du début des années 1940 par des contributions régulières à American Mercury de HL Mencken [sur lui cf The Betrayal of the American Right, M. Rothbard, 2007, ch. 3], où de nombreuses idées de The Coming American Fascism et The Dynamics of War and Revolution ont été avancées à l’origine, des conférences et des débats, des conseils en économie pour EA Pierce & Co. Il rédige et édite son propre bulletin, The Weekly Foreign Letter, qui paraît de 1938 à 1942. Après l’épisode judiciaire pour “sédition” [il est accusé d’être un agent d’influence au service de l’Allemagne] et un long livre à ce sujet, A Trial on Trial [Le procès du procès] (co-écrit avec l’avocat Maximilian St. George), il lance un autre bulletin, The Appeal to Reason, qui durera plus de vingt ans [1946-1972], malgré un tirage qui ne dépassera jamais les 500 abonnés (dont l’ancien président Herbert Hoover, le sénateur Burton K. Wheeler, les généraux Robert E. Wood et Albert C. Wedemeyer, l’ex-colonel Truman Smith et Bruce Barton). Dennis sert également de conseiller en placements pour le général Wood et lui assure des gains confortables. Partageant son temps après la guerre entre sa ferme du Massachusetts et le Harvard Club de New York, il circonscrit sa vie sociale essentiellement à un petit cercle d’amis et de collègues, qui comprend les historiens révisionnistes Harry Elmer Barnes, Charles Callan Tansill et James J. Martin, le politologue Frederick Lewis Schuman (son voisin dans le Massachusetts — et son homologue de sensibilité différente — ainsi que son beau-frère), l’écrivain et ancien co-accusé de “sédition” George Sylvester Viereck, et le publiciste H. Keith Thompson.
Son dernier livre, Operational Thinking for Survival, paraît en 1969. Bien que l’essentiel du manuscrit ait été achevé à la fin des années 1950, le livre resta en jachère faute d’éditeur. Il y reprend ses convictions fondamentales telles qu’elles s’exprimaient 30 ans auparavant ; il justifie ses explications par le cours des événements d’après-guerre, revendique en étude de cas une pensée “opérationnelle” (ou traitement “rationnel-pratique”), décrit la futilité, le gaspillage et le danger d’une guerre froide qui à la fois résulte d’une stupidité moralisatrice et l’entretient, et trouve même le temps de fustiger les critiques néo-classiques de la “Nouvelle économie” dont il avait été l’un des premiers représentants, quoique des plus inhabituels. Peu de temps après la parution du livre, il subit un accident vasculaire cérébral invalidant et ne reste actif que sporadiquement jusqu’à sa mort en 1977 [le 20 août].
Sources : Archives Eroe.