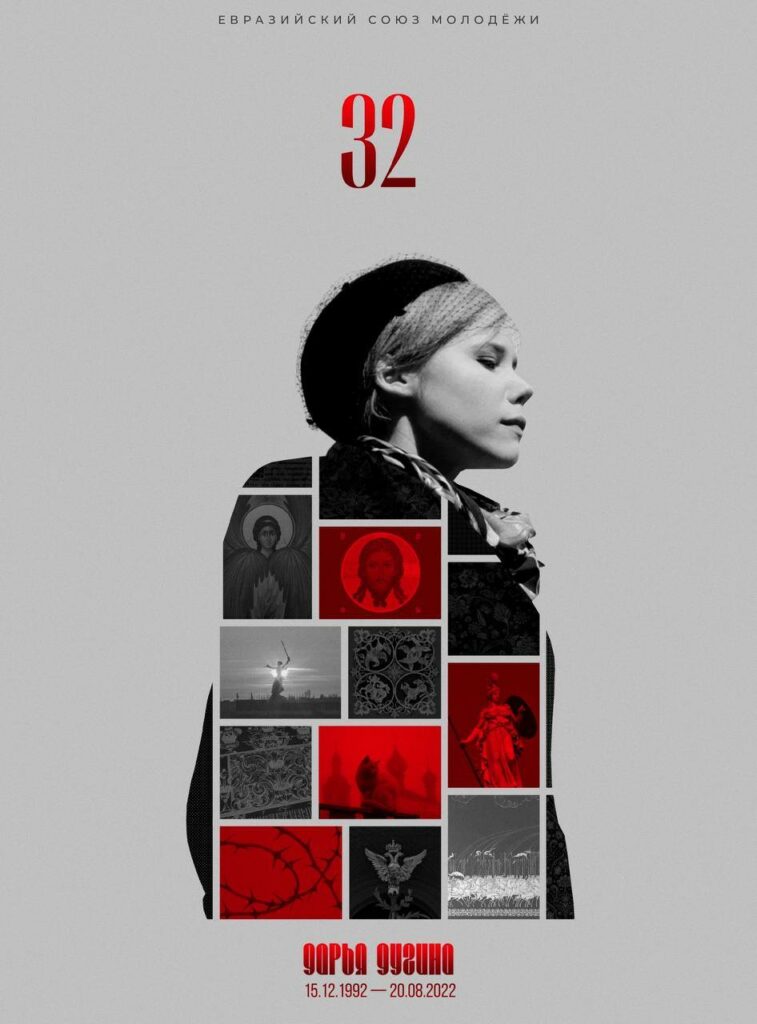Introduction[1]
Les historiens du platonisme tardif adhèrent souvent à une approche qui soutient que l’aspect politique ne fait pas partie de la sphère d’intérêt du néoplatonisme, qui est plutôt supposée être orienté exclusivement vers la contemplation intellectuelle et concentré sur l’apophatique (Ἕν), la hiérarchie des émanations, et les pratiques théurgiques. L’historien allemand du platonisme Ehrhardt en particulier a défendu ce point de vue[2]. Cette position, qui fait l’objet de critiques répétées tout au long de l’ouvrage de Dominic O’Meara, Platonopolis: Platonic Political Philosophy in Late Antiquity[3], peut être remise en question, et l’un des arguments décisifs sur cette question pourrait bien être le cas de l’empereur Julien (331/332-363), qui a non seulement proposé une théorie politique néoplatonicienne développée, mais a également accompli un certain nombre de mesures décisives en vue de son application politique dans la gouvernance de l’Empire.
Julien le Philosophe-Roi
L’empereur Flavius Claudius Julianus, représentant de l’école néoplatonicienne de Pergame, était un platonicien modèle qui non seulement réfléchissait à la nécessité pour le philosophe de s’engager en politique (c’est-à-dire d’être un dirigeant), mais qui, pendant une période très brève mais très intense, fut également empereur de l’Empire romain, incarnant ainsi le projet politique de l’État idéal platonicien. Une telle combinaison de respect pour la vie contemplative et le service politique était rare — il y a eu peu de philosophes-dirigeants dans l’histoire, mais l’un d’entre eux, Marc Aurèle, a inspiré Julien à bien des égards. « Les rêveurs de ce genre sont rares parmi les princes : c’est pourquoi nous devons le respecter [l’empereur Julien] », a fait remarquer l’historien français Victor Duruy[4]. Ce qui distinguait particulièrement Julien de ses prédécesseurs était son obsession sincère pour la philosophie, dont la doctrine néoplatonicienne était, à ses yeux, la plus haute manifestation. Le jeune empereur était particulièrement fasciné par Jamblique (245/280-325/330) de l’école néoplatonicienne syrienne. L’école de Pergame où Julien étudiait était essentiellement une branche de l’école syrienne, et Jamblique était considéré comme une autorité incontestable. Jamblique était le modèle de « mystique et de perfection » de Julien, et dans ses écrits, Julien trouvait « la sagesse la plus parfaite qu’un homme puisse découvrir ». Cependant, comme l’a noté Jacques Benoist-Méchin, biographe de Julien, celui-ci ne se contentait pas d’écouter et de reproduire les enseignements de Jamblique, mais il les complétait et les développait, élaborant la doctrine de l’élément intermédiaire (le « monde intermédiaire »), du Roi Soleil (en trois hypostases) et, ce faisant, détaillant le paysage métaphysique de la philosophie néoplatonicienne[5].
Les trois soleils
L’hypostase la plus élevée du Soleil était le soleil apophatique, identique à l’Un (Ἕν) de Plotin. Le Soleil intermédiaire était la Lumière métaphysique reliant les mondes intelligibles (noétiques) au cosmos. Enfin, la troisième hypostase était le Soleil du monde visible et corporel, qui représentait la limite inférieure des émanations du principe absolu. Pour Julien, la question du lien entre le monde intelligible et le monde matériel (le problème du « Soleil intermédiaire ») était fondamentale. Il cherchait une réponse à la fois sur le plan ontologique et sur le plan politique. Pour lui, comme pour tout platonicien, les plans politique et ontologique sont interconnectés et homologues. Le médiateur, qui pour Julien était Hélios, est à la fois une figure métaphysique et politique : il est roi par rapport à tout ce qui est en dessous de lui, ainsi que représentant du Premier Principe métaphysiquement supérieur.
Pour décrire ce soleil, Julien utilise les noms βασιλεύς, « roi », κύριος, « seigneur », et les verbes ἐπιτροπεύω, « être un gardien » ou « celui qui gère », et ἡγέομαι, « gouverner », « guider », « diriger », « aller de l’avant ». Les parallèles entre Hélios et la figure du souverain imprègnent l’ensemble de son « Hymne au roi Hélios ». Par exemple : « Les planètes dansent autour de lui comme leur roi, à intervalles réguliers, fixés par rapport à lui, et tournent en cercle dans un accord parfait »[6]. Tout comme Hélios, le dieu Soleil, agit comme transmetteur d’idées dans le monde sensible, le philosophe-empereur est le compagnon du Soleil-Roi. « Compagnon » (ὀπᾱδός) est le terme que Julien utilise pour se désigner au début de l’hymne. Selon lui, tout souverain est apte à être le « serviteur » et le « voyant » du « roi des dieux [Hélios] ». De même, le Roi Soleil accorde la sagesse, la connaissance et l’existence à la déesse protectrice de la polis et des États, Athéna — sa sagesse, qui découle d’Hélios, « est le fondement de la communion politique ».
L’Hélios de Julien s’avère également être le fondateur de Rome, ce qu’il prouve en citant une légende selon laquelle l’esprit de Romulus serait descendu sur terre depuis le soleil : « La conjonction étroite d’Hélios et de Séléné, qui partagent l’empire sur le monde visible, tout comme elle avait fait descendre son âme sur terre, fit monter de la même manière celui qu’elle avait reçu de la terre, après avoir effacé par le feu d’un éclair la partie mortelle de son corps ». L’unité de la Lumière comprise métaphysiquement et symbolisant Hélios imprègne tout le système philosophique de Julien. Selon la conception néoplatonicienne, l’Un est toujours apophatique, inexprimable et transcende l’être. Il ne peut être atteint que de manière tangentielle. La forme la plus élevée d’unité est accessible par le biais de ἕνας, ou la participation à l’Un. Ainsi, le cosmos semble se rassembler et graviter vers l’Un sans jamais l’atteindre.
De même, la plus haute hypostase du Soleil-Roi chez Julien est apophatique. La nature de la Lumière trouve son origine dans l’obscurité apophatique du soleil invisible et imprègne à partir de là tous les autres niveaux du cosmos. L’État, compris comme l’Empire, est le rassemblement de nombreux peuples vers cette unité, c’est-à-dire qu’il est une hénadie. Il ne s’agit pas de l’unité et de la lumière elles-mêmes, mais d’une volonté vers elles, d’un mouvement vers elles. Tout comme l’âme ou l’essence du roi descend des sphères supérieures, le royaume lui-même tend vers le roi comme sa source, ce qui confère à la politique une grâce hénadique.
Julien s’était fixé la tâche pratiquement impossible de mettre en œuvre l’idéal platonicien du roi-philosophe dans le contexte réel de l’Empire romain du IVe siècle, de devenir le « compagnon » du soleil et le garant de la justice (δικαιοσύνη) dans un contexte où le christianisme gagnait en puissance et en influence. « Sa principale force motrice était un sens des responsabilités aussi fort que celui de Marc Aurèle le philosophe empereur, qu’il idolâtrait. »[7]
Pendant l’année et demie de son règne impérial (et avant cela pendant plusieurs années en tant que César en Gaule), guidé par les principes de l’État platonicien (comme l’a justement noté Walter Hyde, « Julien a mis en pratique la théorie platonicienne »[8]), Julien a tenté d’harmoniser le système politique avec l’idéal philosophique de la tradition philosophique platonicienne, et il y est partiellement parvenu[9]. Homme d’État accompli, il se révéla être un commandant doué (remportant des victoires remarquables sur les Germains en Gaule et commandant efficacement l’armée jusqu’à sa mort, lors de la dernière bataille contre les Perses au cours de laquelle l’empereur fut tué) et un réformateur radical de la foi païenne qui avait perdu de sa force avec l’avènement de la nouvelle religion chrétienne qui, bien que ses contours fussent encore flous, se fragmentait déjà en d’innombrables courants se livrant à de violentes polémiques.
Julien n’était pas un simple souverain laïc ; il cherchait à incarner l’image idéale du roi-philosophe dans sa conception ontologique — pancosmique —, en stricte conformité avec les schémas symboliques du néoplatonisme. La tolérance religieuse décrétée par Julien reposait également sur de profondes convictions philosophiques. Son décret n’était pas un simple rejet de la christianisation de l’Empire au profit de la laïcité, ni le remplacement d’une religion par une autre. Selon la pensée de Julien, la foi, la religion et l’autorité – le domaine de l’opinion (δόξα) – devaient être subordonnées au principe supérieur du Roi de l’Univers, « celui autour duquel tout existe ». Mais cette soumission ne pouvait être formelle, car toute la structure hiérarchique du principe dirigeant, le Roi-Soleil, était ouverte vers le haut, c’est-à-dire hénadique. Dans la structure de la philosophie néoplatonicienne, on ne peut être certain que de progresser vers l’Un, sans certitude quant à l’Un lui-même, qui est inaccessible. Ainsi, le modèle politique de Julien représentait le principe de l’« Empire ouvert », dans lequel l’impératif était la recherche de la sagesse, mais pas la sagesse elle-même, car, en dernière analyse, la sagesse ne peut être incarnée dans aucun ensemble de dogmes, qu’ils soient chrétiens ou païens. Cependant, la conclusion de cette ouverture était à l’opposé des tendances séculières du New Age. La sacralité et le principe de la lumière sont les impératifs de la philosophie politique de Julien, mais cette gouvernance ne peut être figée dans des lois immuables. Le sens de la lumière est qu’elle est vivante. Il en va de même pour l’Empire ouvert et son souverain. Ici, le concept même de philosophie retrouve son sens profond. La philosophie est l’amour de la sagesse et le mouvement vers celle-ci. C’est la recherche de la lumière, le service au Roi-Soleil, qui l’accompagne. Mais si nous conférons à cette sagesse un caractère formel, nous n’avons plus affaire à de la philosophie, mais à du sophisme. C’est apparemment ce qui a rebuté Julien dans le christianisme : l’enfermement dans des dogmes stricts, le caractère hénadique de l’Empire ouvert était remplacé par un code étranger, et ainsi l’Empire était fermé à ce qui était au-dessus et perdait sa sacralité totale au profit d’une seule version possible de la religion. Pour lui, le domaine des opinions (δόξα) était la sphère du relatif, du contingent. Il devait être orienté vers le Soleil, auquel cas l’opinion devenait orthodoxie, ορθο-δοξία, signifiant « opinion juste », mais ce n’était toujours qu’une opinion.
Ce qui est intéressant dans le destin de Julien, c’est qu’il n’avait aucune aspiration particulière au pouvoir, car il se consacrait principalement à la philosophie et était fasciné par les rituels théurgiques. Julien était avant tout un philosophe, et ce n’est que par la force de l’inévitable, du destin, de la prémonition et du chemin que lui avait tracé Hélios qu’il est devenu souverain. Dans son Éloge funèbre de l’empereur Julien, Libanius remarque qu’il « ne recherchait pas la domination sur les cités, mais leur prospérité », et le rhéteur note que si, à l’époque de Julien, un autre candidat au trône avait pu faire revivre l’hellénisme, Julien aurait « obstinément évité le pouvoir »[10]. Julien était un philosophe condamné par la Providence à descendre, à émaner, et sa mission avait donc un caractère démiurgique et sotériologique. Il était destiné à devenir un souverain, un compagnon du Soleil, en vertu de sa nature philosophique.
Le Soleil du centre absolu
La « médiocrité » du Soleil dont nous avons parlé plus haut et son leadership correspondent à la position du roi-philosophe dans l’État idéal. À l’instar d’Hélios dans son activité démiurgique qui génère ou embellit de nombreux eidoi (« Il perfectionne certaines formes, en crée d’autres, en embellit certaines ou donne la vie, et il n’existe rien qui, en dehors du pouvoir créateur dérivé d’Hélios, puisse voir le jour et naître. »[11]), le philosophe-roi donne aux classes sociales leurs contours propres. Il est le « juste milieu », le conducteur de la connaissance authentique de la nature secrète des choses et le bâtisseur de l’ordre fondé sur cette connaissance authentique. Julien associait Hélios à Apollon, celui qui établit des oracles partout sur terre pour donner aux hommes la vérité d’inspiration divine[12]. Hélios-Apollon est censé être l’empereur ainsi que l’ancêtre du peuple romain, ce qui ajoute à la doctrine politique de Julien la thèse selon laquelle les Romains ont été « choisis par Dieu ».
Hélios-Zeus agit également comme le porteur du principe royal. Même le dieu des mystères nocturnes, Dionysos, qui dans la pensée de Julien devient une autre incarnation du Soleil, Hélios-Dionysos, est traité comme une continuation du même principe d’autorité dans les profondeurs des mondes corporels. Zeus, Apollon et Dionysos sont, selon Julien, les trois points de la démiurgie politique du souverain parfait. Comme Zeus, il gouverne le monde. Comme Apollon, il écrit les lois et veille au respect du sacré orienté vers l’Empire solaire. Comme Dionysos, il est le patron des religions, des cultes et des arts, et supervise également les mystères et les liturgies.
Certains éléments indiquent que la figure du Soleil médiateur a tellement impressionné l’empereur que, lors de sa réforme de l’armée, il a remplacé l’inscription chrétienne sur la bannière impériale In hoc signo vinci (Par ce signe, tu vaincras) par la dédicace mithraïque Sol Invictus (Au soleil invincible). Il est évident que la figure de Mithra est ici utilisée comme une métaphore philosophique et non comme un signe que le mithraïsme a inspiré les réformes religieuses et politiques de Julien. Sol Invictus est le roi Hélios lui-même dans sa nature générale et primordiale. Il pouvait servir de dénominateur commun à diverses figures religieuses dans l’esprit de la synthèse néoplatonicienne ou de ce que le néoplatonicien Proclus appela plus tard la « théologie platonicienne ».
Dans le cas du remplacement de In hoc signo vinci par Sol Invictus, parfois interprété comme le cas le plus frappant de « restauration païenne », on pourrait également voir quelque chose de différent : non pas le remplacement d’un culte par un autre, mais un appel à la source philosophique commune à différentes religions et croyances. Tout comme l’Empire rassemble les peuples et les royaumes, la sacralité impériale à part entière ramène toutes les formes particulières à leur source hénadique. En fin de compte, la croix est aussi un symbole solaire, et son affichage sur la bannière impériale était étroitement lié à la victoire militaire et à l’apogée politique de Rome sous Constantin.
Une tentative de restauration de Platonopolis
L’époque de Julien a vu une tentative de construction d’un empire universel, Platonopolis. En tant que véritable platonicien, Julien a tenté de couvrir et de réformer tous les domaines : la sphère religieuse (introduction du rite de repentance, charité, attribution d’un caractère éthique aux cultes païens officiels, édit sur la tolérance religieuse)[13], la sphère de la vie palatine (rationalisation du personnel de la cour, invitation de philosophes, d’orateurs et de prêtres nobles à la cour, restauration de l’ancien statut et du pouvoir du Sénat) et la sphère financière (restauration de l’autonomie urbaine, transfert aux municipalités du droit de percevoir des impôts en faveur des villes). Mais le cours de l’histoire était déjà prédéterminé. Le christianisme, absorbant certains éléments de l’hellénisme (en particulier, assimilant la doctrine du royaume platonicien et les meilleurs éléments du mysticisme et de la théologie néoplatonicienne), renversa irréversiblement l’édifice délabré de l’Antiquité.
L’historien W.R. Inge a fait remarquer que Julien était « un conservateur alors qu’il n’y avait plus rien à conserver »[14]. L’heure de Julien sonna et un nouveau souverain fit son apparition. Désormais, la sacralité impériale et la mission métaphysique de l’empereur seraient interprétées dans un contexte strictement chrétien comme la figure du katechon (κατέχων), le « reteneur », dont la signification est définie par la structure de l’eschatologie chrétienne, dans laquelle l’empereur orthodoxe est, selon l’interprétation de Jean Chrysostome, considéré comme le principal obstacle à la venue de l’Antéchrist. Mais même dans ce concept de katechon, on peut voir un lointain écho de l’ontologie politique du Roi-Soleil, car l’Empire continue d’être considéré comme un phénomène métaphysique et revêt donc un caractère philosophique dans le byzantinisme. À ce stade, cependant, nous avons affaire à une version considérablement réduite du platonisme politique, plus étroite et plus dogmatiquement délimitée que la portée universelle de la philosophie politique de Julien.
[1] Initialement publié en russe dans la revue Contextes et réflexions : philosophie du monde et l’humain 7. 2A (2018), p. 32-38.
[2] A. Ehrhardt, « The Political Philosophy of neo-platonism » in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, vol. 1, ed. M. Lauria, Naples, 1953, p. 457-82.
[3] Dominic J. O’Meara, Platonopolis: Platonic Political Philosophy in Late Antiquity, Oxford, Clarendon Press, 2003.
[4] V. Duruy, « Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France » in Revue des Études Grecques 17, Paris, 1883, p. 177.
[5] Jacques Benoist-Méchin, L’Empereur Julien ou le rêve calciné (331-363), Paris, Perrin, 1997.
[6] Julien, « Hymn to King Helios, dedicated to Sallust » in Julien, Complete Works, Delphi Classics, 2017.
[7] F.F. Zelinskii, Rimskaia Respublika, Saint Petersburg, Aleteia, 2016, p. 419.
[8] W. Hyde, « Emperor Julian », The Classical Weekly 37, 3, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1843.
[9] Polymnia Athanassiadi-Fowden, Julian and Hellenism: An Intellectual Biography, Oxford, Clarendon Press, 1981.
[10] Libanii, Rechi, vol. 1, Saint-Pétersbourg, Kvadrivium, 2014.
[11] Julien, Hymne au roi Hélios.
[12] Apollon occupe également une place centrale dans La République de Platon : dans le quatrième livre, il est reconnu comme le seul véritable législateur. Selon Socrate, les lois de l’État idéal ne doivent pas être établies sur la base de coutumes et d’habitudes antérieures, ni sur la volonté singulière d’une personne, mais sur un principe transcendant et divin. Ainsi, les lois de l’État peuvent être comprises comme les prophéties de Delphes, dont l’interprétation est détenue par le roi-philosophe de l’État idéal.
[13] Au IVe siècle, la religion païenne était dans un état de faiblesse considérable. Dans son ouvrage Rimskaia Imperiia (l’Empire romain), Zelinsky note qu’à l’époque de Julien, « la vue du temple le plus important du monde antique, le temple d’Apollon à Delphes, provoquait le découragement. Et Julien, désireux d’entendre la voix des oracles de Delphes, y envoya ses théurges. La dernière Pythie se montra digne de ses prédécesseurs. La triste réponse fut : ‟Transmettez ce message au seigneur : il ne reste que des ruines du temple, Phébus n’est plus le maître de ce sanctuaire et a perdu la couronne de laurier des prophètes, la source de l’inspiration s’est tarie et les flots castaliens ont cessé de couler.” » — F.F. Zelinskii, Rimskaia Imperiia, Saint-Pétersbourg, Aleteia, 2020, p. 425.
[14] W.R. Inge, « The Permanent Influence of Neoplatonism upon Christianity », The American Journal of Theology 4:2, Chicago, University of Chicago Press, 1900.