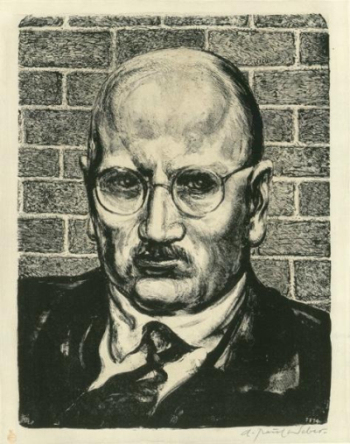Un peu de contexte historique : cette conversation entre Mussolini et Niekisch a eu lieu en 1935, alors que les relations entre l’Allemagne et l’Italie étaient encore tendues en raison de l’assassinat du premier ministre autrichien et de l’expansion allemande. Ernst Niekisch, national bolchevik allemand et opposant à Hitler, dont le magazine a été interdit l’année précédente, cherche des alliés dans la lutte contre Hitler et en voit un en la personne du dirigeant italien Benito Mussolini.
C’est dans un petit restaurant que Tavolato m’a présenté au journaliste Engerli. Engerli était proche de Mussolini. Il était le rédacteur en chef des Affari esteri, le journal officiel de politique étrangère publié par le régime fasciste. Engerli, un homme intelligent, clairement d’origine suisse, malgré ses relations étroites avec le régime fasciste, eut toujours une attitude critique à son égard. Il fut certainement fusillé en 1942 en même temps que le comte Ciano. Après quelques paroles, Engerli m’a demandé si je voulais rencontrer Mussolini. J’ai répondu que je ne pouvais pas envisager que Mussolini s’intéresse à ma modeste personne. Engerli m’a dit que cela ne me concernait plus. J’ai répondu que j’étais prêt à le rencontrer à condition que je ne fasse aucune démarche en ce sens et qu’Engerli se charge d’organiser la rencontre. Je l’ai informé que nous avions l’intention de nous rendre à Naples et à Sorrente pendant environ huit jours. Pendant ce temps, il pouvait s’occuper de tout ce qui était nécessaire.
Le jour de l’Ascension du Seigneur, nous sommes rentrés de Sorrente à Rome. Le directeur de l’hôtel m’a informé – il était déjà onze heures du soir – que j’avais été appelé plusieurs fois au téléphone du Palazzo Chigi, où se trouvait le ministère des Affaires étrangères, et que je devais m’y présenter dès mon arrivée. Un journaliste associé à Engerli m’a rendu visite à l’hôtel le soir même. Il était au courant de tout et m’a dit que je devais arriver au Palazzo Chigi le lendemain. Je recevrai également une invitation de Mussolini. La réunion était prévue pour le lundi suivant à 18 heures.
J’ai été chaleureusement accueilli au Palais Chigi. L’invitation était rédigée sur un ton aimable ; elle mentionnait ma revue Widerstand et ma brochure « Dans l’atmosphère étouffante des pactes ». Je devais garder secret le contenu de la conversation à venir et ne rien publier.
Après la visite au Palazzo Chigi, par l’intermédiaire d’un journaliste allemand, j’ai informé l’ambassadeur allemand à Rome, M. von Hassel, de ce qui se passait. Je lui ai demandé de me faire savoir que j’étais prêt à écouter tous ses souhaits si l’ambassadeur jugeait nécessaire de me donner des directives avant l’audience. M. von Hassel m’a invité à sa résidence le lundi à quatre heures.
A l’heure prévue, j’étais à l’ambassade d’Allemagne. M. von Hassell me reçut dans son bureau. Il a trouvé remarquable l’invitation que j’avais reçue. Elle avait suscité un vif intérêt dans la colonie allemande. L’ambassadeur estime que les relations entre l’Allemagne et l’Italie sont encore tendues : Mussolini et Hitler ne se comprennent pas bien. Mussolini a l’intention d’envahir l’Abyssinie. Dès qu’il se lancera dans l’aventure abyssine, il aura un besoin urgent de l’aide allemande. Je devais le pousser à envahir l’Abyssinie autant que possible, car Mussolini serait alors entre les mains de l’Allemagne. J’ai été profondément offensé par cette proposition – faire tout ce qui était possible pour renforcer Mussolini dans son intention d’attaquer l’Abyssinie, si l’occasion se présentait au cours de la conversation.
Nous avons ensuite parlé de la politique allemande. J’ai informé l’ambassadeur que j’étais contre Hitler et que je considérais sa politique comme fatale, destructrice pour les Allemands. M. von Hassell a hoché la tête d’un air pensif, m’a regardé longuement, puis a pris son courage à deux mains pour une conversation franche. Lui, l’ambassadeur du Troisième Reich, m’a confié qu’il avait lui aussi de sérieux doutes. Il m’a demandé ce que je considérais comme une faiblesse particulière de la politique allemande. J’ai répondu que cette faiblesse était la ligne anti-bolchevique d’Hitler, qui le ruinerait ; elle l’obligerait inévitablement à se battre sur deux fronts et le conduirait finalement à la tombe. Hassell a répondu qu’il considérait la politique antibolchevique d’Hitler comme dangereuse et douteuse, tout comme moi. Avant de partir, je lui promis de lui envoyer un rapport sur ma conversation avec Mussolini.
De l’ambassade d’Allemagne, je me suis rendu au Palazzo Venezia. Deux gardes en civil se tenaient aux portes et vérifièrent mes documents. La salle d’attente était une petite salle voûtée, meublée avec goût. Deux personnes s’y trouvaient : une journaliste néerlandaise et un Américain. On m’a dit que la journaliste était une fan passionnée de Mussolini. Chaque jour, elle restait assise pendant des heures dans la salle d’attente et n’apercevait Mussolini qu’à quelques reprises, sans jamais être autorisée à lui parler. Mais elle était heureuse de se sentir proche du « grand homme ». L’Américain a été invité à voir Mussolini avant moi, mais il n’est pas resté plus de cinq minutes. Puis ce fut mon tour.
Mussolini me reçut dans un grand et long hall bien connu, où il n’y avait aucun meuble à l’exception de son bureau. Derrière ce bureau se tenait Mussolini dans sa posture habituelle : les bras croisés et une expression de César. J’ai dû parcourir une distance considérable entre les portes et le bureau. Mussolini me proposa de m’asseoir, mais il resta debout. Après quelques mots formels à mon sujet, il me demanda comment j’étais entré en politique. Je lui ai répondu que j’étais un social-démocrate, que j’avais ensuite travaillé dans des syndicats et que j’avais été fortement influencé par le marxisme. Ma réponse a eu un effet étrange sur lui. Les traits tendus de son visage se sont aplanis, son visage a pris une expression jeune et joyeuse. Il s’est rapidement assis, s’est penché vers moi à travers le bureau et m’a dit : « N’est-il pas vrai qu’il faut passer par l’école du marxisme pour acquérir une véritable compréhension des réalités politiques ? Ceux qui ne sont pas passés par l’école du matérialisme historique resteront de simples idéologues. » Après cela, il m’a demandé ce que j’avais contre Hitler. Je lui ai répondu que j’avais beaucoup de choses contre Hitler dans mon cœur, mais que j’étais surtout contre sa politique étrangère. Mussolini voulait savoir précisément ce que je trouvais à redire. Je lui ai dit qu’Hitler espérait à tort obtenir des puissances occidentales la permission de détruire la Russie et d’en faire sa proie. Si Hitler devient le seul maître de la Russie, il sera si fort qu’il menacera la position privilégiée des puissances anglo-saxonnes. Ces puissances ne le permettront jamais. La position anti-russe d’Hitler aura pour conséquence que l’Allemagne devra se battre sur deux fronts, et elle en périra inévitablement. « Que suggérez-vous à la place ? demanda Mussolini. J’ai répondu : « Je suis d’accord avec ce que vous avez dit sur les nations prolétaires. Les nations prolétaires sont l’Allemagne, l’Italie, la Russie et peut-être le Japon. Cette union n’aurait pas d’égal, personne ne pourrait lui résister, elle pourrait vaincre l’Angleterre et l’Amérique en Asie, tout comme en Europe. »
Mussolini frappa avec enthousiasme la table du poing. « C’est exactement ce que je ne cesse de répéter à Hitler ! » s’exclame-t-il. « Si Hitler poursuit sa politique stupide en poussant la Russie dans les bras de la France et de l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et toute l’Europe périront« .
Mussolini a également abordé la question de l’Anschluss de l’Autriche par l’Allemagne. Il reconnaît que l’Autriche, en termes de structure, d’économie et de politique culturelle, gravite autour de l’Allemagne. Cependant, il n’accepterait en aucun cas l’annexion de l’Autriche à l’Allemagne sur la base du droit national. Le problème n’est pas seulement que l’Allemagne se rapprocherait alors des frontières de l’Italie. Le poids de l’Allemagne deviendrait trop lourd pour que l’Italie puisse résister à la pression directe de l’Allemagne sur ses frontières. Il en a déjà fait part à Berlin à plusieurs reprises. Mais Hitler ne comprend pas les fondements de la politique, il ne connaît pas la formule qui en est la base : « Je donne pour que tu donnes ». Hitler veut toujours recevoir, mais jamais donner quoi que ce soit à qui que ce soit. C’est très facile pour lui, bien sûr, mais s’il continue à agir uniquement en sa faveur, il ne trouvera bientôt plus de partenaires.
J’ai demandé si Mussolini accepterait l’Anschluss en réponse à l’invasion de l’Abyssinie par l’Italie. Mussolini a rapidement répondu en me demandant comment je savais qu’il avait l’intention d’envahir l’Abyssinie. J’ai répondu que pour comprendre cela, il fallait avoir une vision politique : il ne pouvait pas cacher les grandes manœuvres qu’il avait entreprises pour résoudre en fin de compte la question de l’Abyssinie.
Mussolini a souri, a réfléchi brièvement, puis a dit : « Qui vivra verra ».
Il s’est ensuite enquis de la situation de l’Ééglise évangélique en Allemagne. J’ai compris l’intention derrière cette question. Mussolini voulait connaître la solidité des positions intérieures d’Hitler. Avait-il assez de force pour vaincre la résistance de l’Église protestante ? Hitler avait capitulé devant l’Église catholique ; ferait-il de même avec les protestants ?
J’ai dit à Mussolini qu’Hitler avait réussi à réduire l’Église protestante en ruines. Seule la résistance de l’Église confessante est notable. La plupart des pasteurs avaient peur de devenir des martyrs ; ils n’étaient pas comme les premiers chrétiens qui allaient volontiers sur le bûcher. Mussolini sourit et dit que les pasteurs étaient devenus trop complaisants.
Il s’est ensuite levé de derrière son bureau, m’a serré la main chaleureusement et m’a dit que lorsque je reviendrais à Rome, je devais l’en informer et qu’il me recevrait plus longuement. Il était parfaitement au courant de mes activités journalistiques.
La conversation a duré environ une heure.
Le fait que Mussolini, contrairement à ses sages jugements, se soit finalement rallié à la ligne politique hitlérienne s’explique par le fait qu’à la suite de sa campagne d’Abyssinie, il est tombé dans l’esclavage de la dette envers les Allemands.